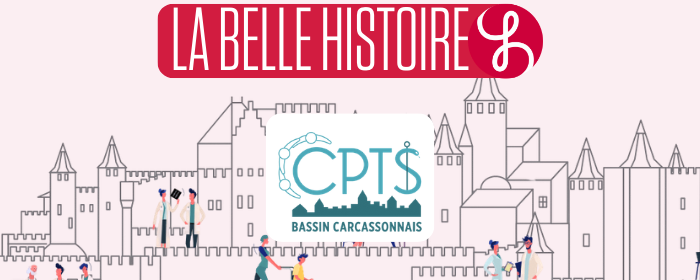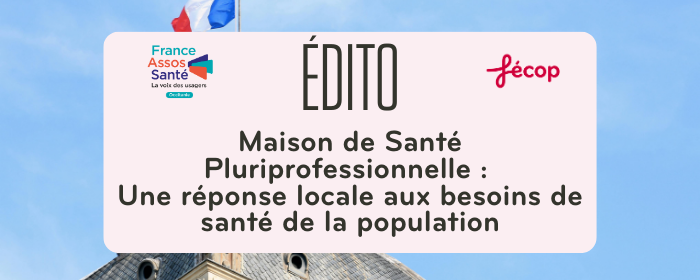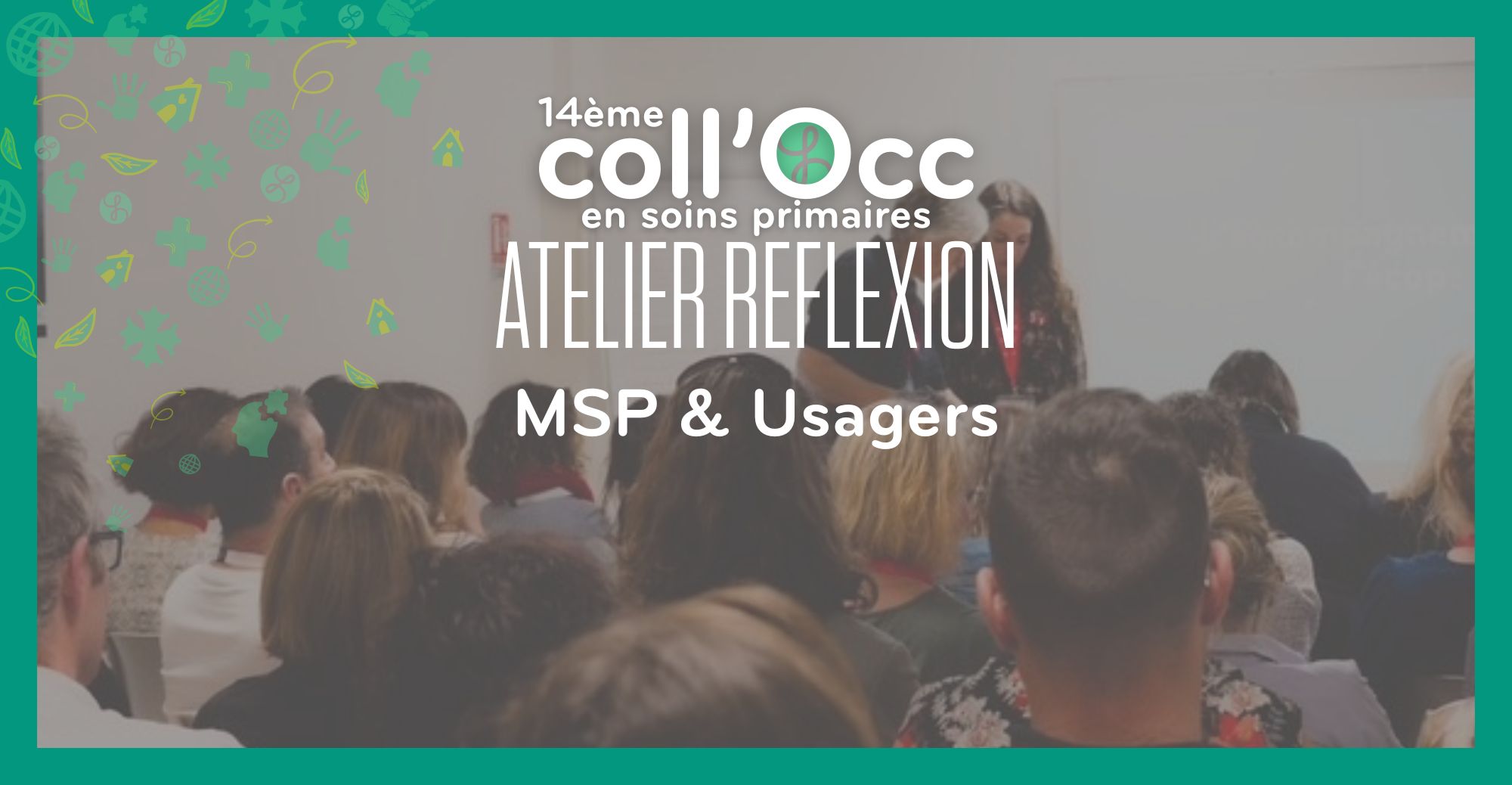
Pour cette édition du Coll’Occ, nous avons souhaité proposer un temps réellement différent : des ateliers participatifs, construits sous forme de world café, pour permettre aux professionnels de santé des MSP et des équipes de soins primaires de réfléchir ensemble à l’avenir de l’accès à la santé sur leurs territoires.
Cet atelier, pensé comme un temps d'intelligence collective, nous nous a permis de nous pencher ensemble sur les conditions d’une coopération entre MSP et usagers.
Ils l’ont fait : l’expérience inspirante d’une MSP accompagnée par le COPS et Fécop
L’équipe de la MSP de Bessèges a partagé un retour d’expérience structurant. Accompagnée par Fécop et par le Centre Opérationnel du Partenariat en Santé (COPS) — structure occitane experte du partenariat en santé — l’équipe a progressivement intégré les patients dans plusieurs projets.
Un groupe de travail « communication » a d’abord été constitué avec des patients, permettant d’améliorer la lisibilité des contenus et de co-construire une formation aux
Fort de cette dynamique, un groupe d’usagers précédemment engagé dans un ETP dépression a proposé de co-concevoir un séjour thérapeutique. Le co-accompagnement de Fécop et du COPS a aidé l’équipe à analyser ses pratiques, à choisir des formes de participation pertinentes et alignées avec ses valeurs, sans tomber dans l’écueil du “questionnaire consommateur” peu souhaité par les professionnels.
Une illustration concrète d’une implication utile, progressive et enthousiasmante.
Table 1 – Écouter les usagers pour améliorer la pertinence des soins
Constats / Situation actuelle
- Des difficultés à recruter et mobiliser les usagers
Les retours mettent en évidence un frein majeur : la difficulté à recruter des usagers prêts à s’impliquer dans la vie de la MSP. Ce manque de participation peut s’expliquer par une faible visibilité des démarches proposées, un manque d’intérêt perçu ou une motivation limitée pour ce type d’engagement. Cette réalité rend nécessaire une réflexion approfondie sur les moyens de rendre la participation plus accessible, plus attractive et mieux comprise.
- Des ressources limitées pour structurer la participation
Le groupe souligne également que le financement constitue un obstacle supplémentaire. Les ressources disponibles ne permettent pas toujours de formaliser ou d’animer des actions de participation dans de bonnes conditions. L’absence d’éléments documentés dans les notes du premier groupe montre d’ailleurs que la participation des usagers est encore peu structurée et qu’elle gagnerait à être mieux intégrée dans le fonctionnement global de la MSP.
Idées / Pistes d’actions
- Structurer des outils de recueil des besoins
Pour mieux comprendre les attentes des usagers, il est essentiel de mettre en place des outils simples et accessibles favorisant leur expression. Les questionnaires de satisfaction permettent de collecter des retours structurés concernant leur expérience. Une boîte à idées, en ligne ou sur place, facilite l’expression spontanée et continue. Enfin, le recueil d’expériences ou de témoignages apporte une vision plus qualitative du vécu des patients, permettant de révéler des besoins ou difficultés parfois peu visibles.
- Impliquer directement les usagers dans la vie de la MSP
L’implication d’usagers dans des instances dédiées, telles qu’une commission interne, permettrait de formaliser leur participation et de leur donner un rôle actif dans les décisions. La mobilisation de patients ambassadeurs, de patients partenaires ou de pair-aidants contribue aussi à aller vers les publics plus isolés, tout en renforçant la représentativité des points de vue recueillis. Leur participation aux groupes de travail constitue un levier fort pour intégrer leur expertise d’usage dans la construction et l’évaluation des actions.
- Développer des activités participatives et thématiques
La mise en place d’ateliers thématiques, d’ateliers thérapeutiques ou de groupes de marche offre aux patients des espaces d’échange conviviaux et utiles. Ces formats permettent d’aborder des sujets inscrits dans le projet de santé de la MSP, tout en créant des moments de dialogue direct entre professionnels et usagers. L’organisation de soirées thématiques ou d’événements publics, comme la projection d’un film suivie d’un débat, favorise également l’engagement et stimule l’expression collective.
- Renforcer la communication pour mobiliser les usagers
Une communication visible, régulière et adaptée est indispensable pour surmonter les difficultés de recrutement. L’utilisation des réseaux sociaux, du site internet, de l’affichage et des campagnes de prévention peut toucher un large public. La présence aux forums des associations ou lors de portes ouvertes contribue à faire connaître la MSP et ses initiatives. Une communication ciblée auprès des élus, associations locales ou travailleurs sociaux permet de relayer l’information vers les personnes les moins connectées.
Conditions de mise en œuvre
- S’appuyer sur des événements publics et des temps ouverts
Organiser des portes ouvertes, participer à des manifestations locales ou tenir des stands lors du forum des associations permet de rencontrer les usagers dans un cadre accessible et informel. Ces événements facilitent la première prise de contact, la présentation des projets et la mobilisation des futurs participants.
- Créer une organisation interne dédiée à la participation
La constitution d’un groupe de travail consacré à la participation des usagers offre un cadre pour coordonner les initiatives, structurer les actions et suivre leur mise en œuvre. L’intégration des usagers au projet de santé renforce la légitimité du processus et garantit que leur contribution est réellement prise en compte dans les orientations de la MSP.
- Utiliser des relais et des supports variés pour communiquer
La mobilisation de différents supports de communication — réseaux sociaux, affichage, diffusion via élus ou associations — permet de toucher des publics diversifiés. Les travailleurs sociaux, notamment ceux du CCAS, peuvent également relayer les informations auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Cette diversité de canaux est essentielle pour créer une dynamique d’engagement durable.
Idées phares à transmettre
- Lever le frein principal : la difficulté de recrutement des usagers
Le recrutement constitue aujourd’hui l’obstacle majeur à la participation. Une communication proactive, multicanale et régulière est indispensable pour faire connaître les démarches, valoriser les actions menées et encourager l’engagement des usagers.
- Mobiliser une diversité d’usagers et de formats pour enrichir la participation
L’implication de patients partenaires, d’ambassadeurs et de pair-aidants permet de diversifier les profils et de renforcer le lien avec les usagers les plus éloignés. L’utilisation de formats variés — ateliers thématiques, groupes de marche, soirées-débats, retours d’expérience — favorise l’expression de chacun selon ses préférences et contribue à enrichir la compréhension des besoins réels.
- Favoriser la participation des usagers à l’évaluation et à la diffusion des actions
Associer les usagers à l’évaluation des projets et à la communication des résultats renforce leur sentiment d’utilité et valorise leur contribution. Cela permet également d’améliorer la transparence, d’ajuster les actions menées et d’entretenir une dynamique participative pérenne.
Table 2 – Encourager la participation des usagers… sans l’imposer
Proposition de fusion des réponses des groupes pour la table 2 :
Constats / Situation actuelle
- Les usagers peuvent évoluer dans leur niveau d’implication
Plusieurs observations montrent que les patients développent progressivement leur capacité d’agir lorsqu’ils bénéficient des services proposés par la MSP. Cette montée en compétence, liée à l’expérience de soins, peut les amener à s’investir davantage dans la vie de la structure. Cela souligne l’importance d’un accompagnement progressif plutôt que d’une injonction à participer.
- Le partenariat nécessite une évolution des pratiques professionnelles
Le second groupe met en évidence que le statut de « passif » ne correspond pas à la réalité d’un patient. Pour favoriser la participation, la démarche collective de l’équipe doit évoluer, notamment en reconnaissant pleinement le patient comme un acteur de soin. Un ajustement des postures professionnelles est donc nécessaire pour installer un véritable partenariat.
Idées / Pistes d’actions
- Co-construire les parcours grâce à des ambassadeurs en santé
L’implication d’ambassadeurs en santé, issus des usagers, permettrait de co-définir les parcours de soins et de mieux prendre en compte l’expérience vécue des patients. En jouant un rôle de relais, ces ambassadeurs facilitent la compréhension mutuelle entre professionnels et usagers, et rendent la participation plus naturelle et progressive.
- Identifier des personnes-relais à l’intérieur de la MSP
La désignation d’une référente clairement identifiée au sein de la MSP offre un point d’entrée lisible pour les usagers souhaitant s’impliquer. Cette présence repérable rassure, facilite les échanges et permet aux patients d’exprimer leurs idées ou leurs besoins sans crainte de déranger. Elle constitue un soutien concret pour encourager une participation choisie et non imposée.
- Favoriser l’expression mutuelle et la reconnaissance réciproque
Encourager des espaces où patients et professionnels peuvent partager leurs représentations, leurs besoins et leurs attentes favorise une véritable dynamique de co-construction. Des temps d’expression mutuelle, des consultations conjointes ou des démarches communes permettent d’aligner les visions et de reconnaître la place de chacun dans la relation de soin. Recruter un patient partenaire ou un pair-aidant renforce cette logique et permet d’incarner le postulat du « patient acteur ».
Conditions de mise en œuvre
- Créer une commission d’usagers visant l’autonomie
La mise en place d’une commission d’usagers, pensée dès le départ avec une visée d’autonomisation progressive, offre un cadre concret pour organiser leur participation. Elle permet aux usagers d’exprimer leurs priorités, d’identifier des besoins collectifs et de proposer des améliorations, tout en construisant leur capacité d’agir.
- Maintenir une proximité réelle avec les citoyens
Encourager la participation passe par une proximité assumée entre la MSP et ses usagers. Une présence sur le terrain, des échanges informels et un lien régulier avec les habitants permettent de créer un environnement favorable où la participation devient une possibilité accessible. Repérer des usagers plus disponibles peut également faciliter l’engagement de premiers volontaires.
Idées phares à transmettre
- S’appuyer sur des portes d’entrée existantes pour engager les usagers
Les infirmiers Asalée, les ateliers d’éducation thérapeutique ou d’autres actions déjà bien identifiées constituent des points d’entrée privilégiés pour encourager une participation progressive. Ces espaces, où les patients se sentent en confiance, facilitent leur transition vers un rôle plus actif sans créer de pression ou d’obligation.
- Valoriser l’expertise et les savoirs des usagers
Reconnaître la valeur de l’expérience des patients est essentiel pour les encourager à s’impliquer. En valorisant leurs compétences, leurs savoirs issus du vécu ou leur capacité à aider d’autres usagers, la MSP renforce leur légitimité et les invite à devenir acteurs. Cela rejoint le principe central rappelé par le second groupe : le patient est un acteur à part entière, et cette évidence doit guider les pratiques professionnelles.
Conclusion globale
Les deux tables montrent que, malgré des freins partagés (recrutement, communication, posture), les MSP disposent de leviers simples et accessibles pour intégrer les usagers de façon progressive et adaptée. Qu’il s’agisse d’écoute, de participation ou de co-construction, la dynamique repose sur une communication claire, une reconnaissance du patient comme acteur et une organisation interne facilitatrice. Les retours terrains confirment que l’implication des usagers est non seulement possible, mais source d’élan collectif et d’amélioration des pratiques.
Pour aller plus loin, découvrez des outils élaborés avec nos partenaires visant à comprendre et à améliorer le partenariat entre Usagers et Maisons de Santé Pluriprofessionnelle :
Le guide de l’implication des usagers à destination des équipes de soins primaires.
Un guide conçu avec le centrer Opérationnel du Partenariat en Santé et France Assos Occitanie.
https://www.fecop.fr/sites/forms-etc/files/upload/GUIDE-~3.PDF
L’enquête régionale sur l’implication des usagers en soins primaires dans les ESP et MSP d’Occitanie :
https://www.fecop.fr/boite-a-outils/rapport-denquete-limplication-des-usagers-en-soins-primaires-dans-les-esp-msp-doccitanie
Une vidéo et des flyers pour mieux faire connaître les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles :
https://www.fecop.fr/actualites/des-flyers-pour-mieux-faire-connaitre-les-maisons-de-sante-pluriprofessionnelles
Notre article « L’implication des usagers dans les soins de proximité : un modèle inspirant en Occitanie » :
https://www.fecop.fr/actualites/limplication-des-usagers-dans-les-soins-de-proximite-un-modele-inspirant-en-occitanie
Demander un accompagnement pour développer vos projet implication des usagers auprès des chargés de missions Fécop